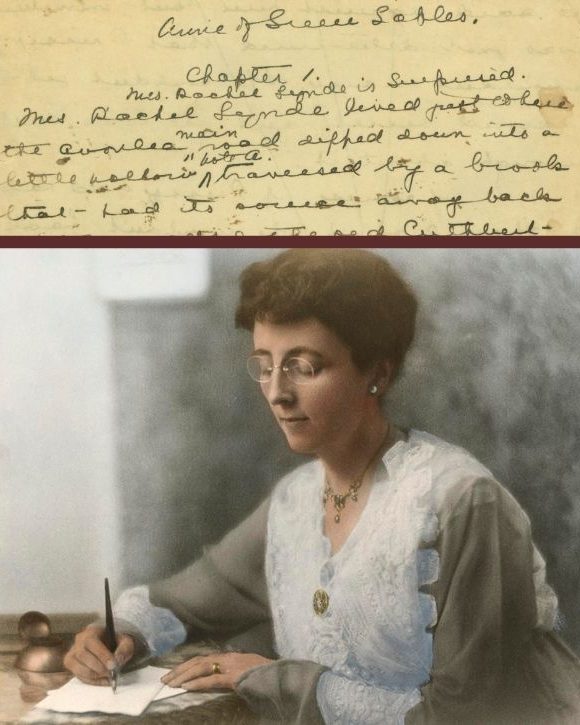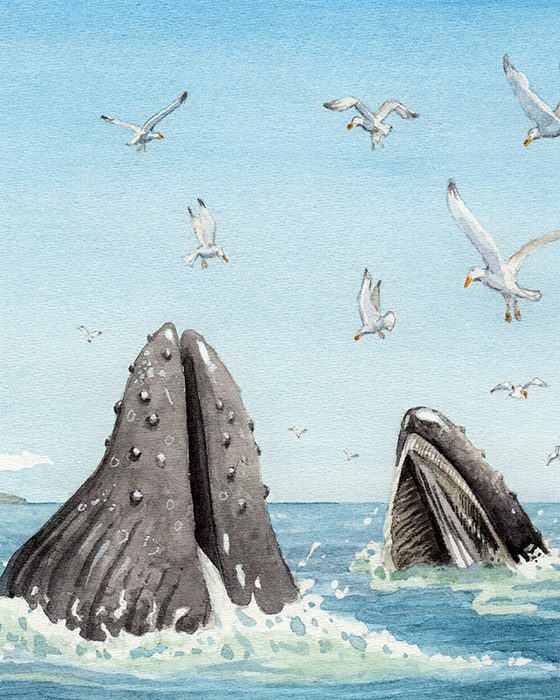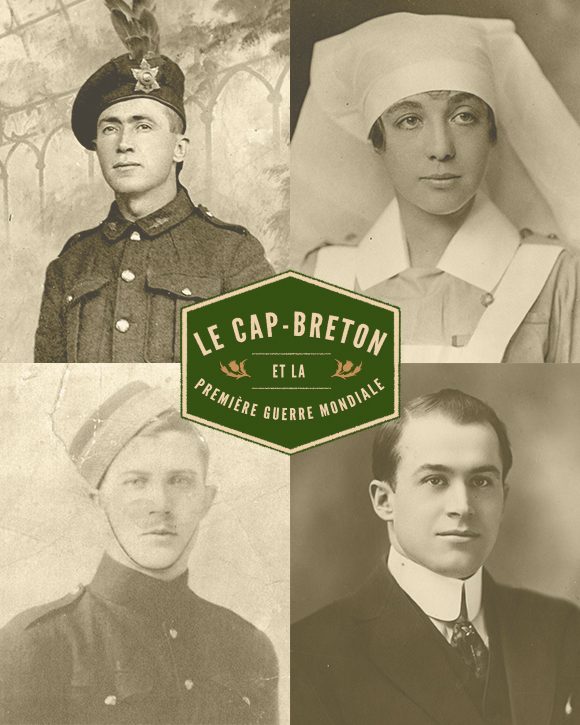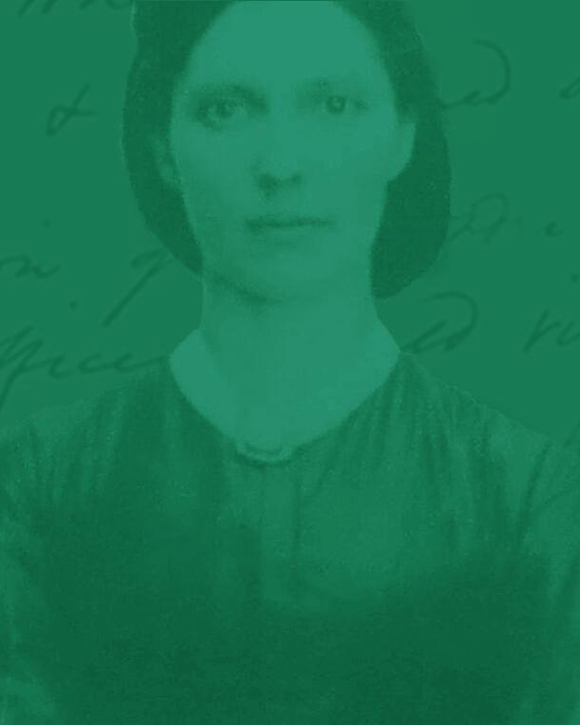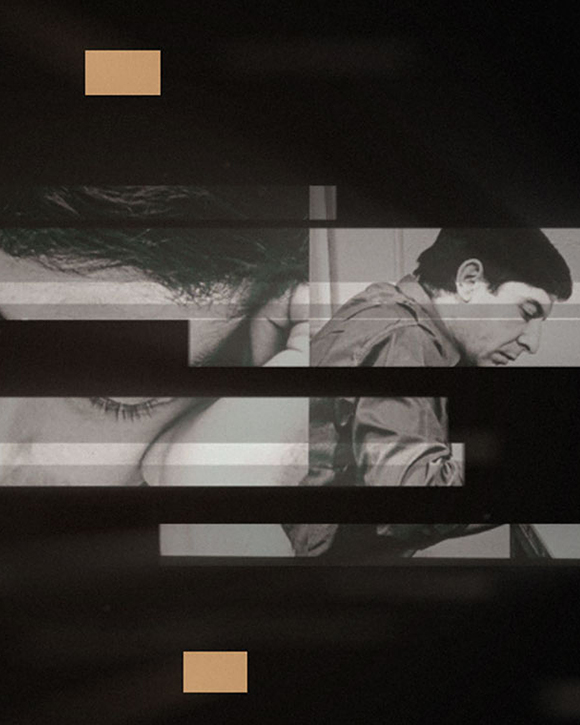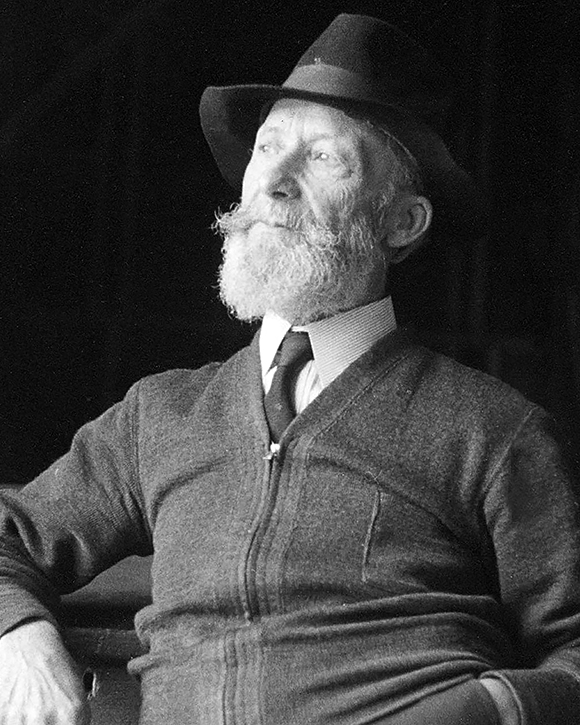Histoires de chez nous
Demandez un investissement de 25 000 $. La plateforme de création de sites Web de MNC propose déjà des formats, vous permettant d’orienter votre travail sur la création des contenus de votre histoire numérique. Les Histoires de chez nous sont habituellement produites en 18 à 24 mois environ.
Clôture de l'appel : 1 décembre 2025
Statut
fermé
Investissement
25 000 $
Les projets incluant une troisième langue sont admissibles à des fonds supplémentaires
Limite
Un projet à la fois par requérant
Nouveauté Plateforme de conception de sites Web !
Découvrez les possibilitésVous souhaitez participer à l'aide à la préparation d'une demande pour renforcer votre proposition?
Inscrivez-vous dès maintenantAperçu
Administré par le Musée canadien de l’histoire, Musées numériques Canada (MNC) est un programme d’investissement visant à renforcer la capacité numérique des musées et organisations patrimoniales, culturelles et autochtones partout au Canada, et à offrir à la population un accès unique à des histoires et expériences diverses.
Du financement et du mentorat sont fournis aux organisations pour concevoir un site Web Histoires de chez nous au moyen de la plateforme de conception de sites Web de MNC.
Remarque : Les organisations qui souhaitent développer du début à la fin un projet en ligne accessible, avec l’aide d’une agence de développement Web, sont invitées à faire une demande de financement dans le volet Projets numériques.
MNC est centré sur les histoires numériques, c’est-à-dire le « digital storytelling ». Les projets proposés doivent raconter une histoire et créer une expérience utilisateur pour un public cible précis. L’histoire s’appuie sur des messages clés, des thèmes ou sur ce que le public va retenir de son expérience. Elle détermine le choix des contenus et des collections.
Les projets proposés ne peuvent donc pas se limiter à des collections ou des archives consultables en ligne. Les sites Web institutionnels ou d’entreprises et les projets de numérisation ne sont pas admissibles.
Les projets en ligne doivent être présentées en français et en anglais, mais peuvent aussi comporter d’autres langues. Les projets doivent répondre aux normes d’accessibilité numérique, permettant aux utilisateurs d’accéder au contenu partout dans le monde, gratuitement et sans équipement acheté (comme des casques de réalité augmentée).
Musées numériques Canada (MNC) s’engage à faire progresser l’équité, la diversité, l’inclusion et l’accessibilité (EDIA) au sein du secteur. Nous nous engageons à renforcer l’accès au financement de MNC dans l’ensemble du pays, y compris pour les communautés rurales et nordiques. MNC reconnait la relation unique et fondée sur les droits entre les Premières Nations, les Inuits, les communautés métisses et le gouvernement du Canada, et soutient les droits des peuples autochtones comme ils sont énoncés dans le rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
Bien que MNC accepte les propositions de toutes les organisations admissibles, une priorité est de faire tomber certaines barrières pouvant se dresser devant des groupes particuliers. Cette considération se reflète dans les critères du programme et dans les évaluations du comité-conseil, l’objectif étant que 25 % des projets soient issus des groupes prioritaires. Cette décision reste à la discrétion du comité-conseil et dépend des propositions reçues.
Les groupes prioritaires sont définis comme des organisations qui ont reçu le mandat de soutenir et qui sont dirigées par les Premières Nations, les Inuits et les communautés métisses, les communautés de langues officielles évoluant en contexte minoritaire, les personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes, les personnes en situation de handicap, les membres des communautés 2ELGBTQI+ ou qui représentent la diversité de genre, les personnes noires, les communautés racialisées, et toutes les personnes se trouvant à l’intersection de ces groupes.
Pour respecter l’esprit du programme de MNC, les propositions doivent décrire un projet en ligne qui est respectueux, ouvert, inclusif et accessible. Le projet doit montrer du respect pour le thème qu’il entend aborder, ainsi que pour les communautés et groupes concernés. Et surtout, le projet ne peut pas être utilisé à des fins politiques, idéologiques ou religieuses ni à des fins commerciales ou de collecte de fonds. Par exemple, les projets ne peuvent pas contenir des éléments visant à promouvoir la vente de biens ou de services.
Les organisations demandeuses disposant d’un mandat EDIA tel que décrit ci-dessus sont invités à remplir le questionnaire sur la plateforme de demande en ligne.
Questionnaire sur l’équité, la diversité, l’inclusion et l’accessibilité (échantillion de questions)
MNC investit 25 000 $ CAN dans chaque Histoire de chez nous produite en anglais et en français. Examinez les coûts admissibles de MNC dans la section « Questions et astuces ».
Si l’Histoire de chez nous est destinée à être produite dans une troisième langue :
- Comme les coûts de traduction peuvent varier en fonction de la langue, le montant de l’investissement fourni par MNC est de 25 000 $, plus les coûts réels de la traduction vers la troisième langue et une allocation de 2 000 $ versée à l’organisation.
- MNC se réserve le droit de fixer un investissement maximal pour les coûts de traduction de la version dans une troisième langue, en fonction des fonds disponibles. Les organisations pourraient être appelées à ajuster leur nombre de mots. À titre indicatif, les Histoires de chez nous comptent généralement entre 10 000 et 20 000 mots afin d’offrir une expérience de narration numérique engageante et accessible.
MNC est un programme d’investissement plutôt qu’une subvention. Les organisations bénéficient du soutien et des conseils de l’équipe de MNC tout au long du développement de leur projet, jusqu’à leur lancement. Les fonds sont remis en phases, après la révision et l’approbation des produits livrables.
Les projets en ligne du volet de financement Histoires de chez nous sont créés au moyen d’une plateforme de conception WordPress pratique, qui fonctionne comme un gabarit.
Les organisations financées peuvent accéder à la plateforme de conception du site Web et au guide d’utilisation une fois l’entente signée.
L’appel de projets annuel de MNC est lancé le 15 juin, avec comme date limite le 1er décembre.
Toutes les propositions doivent être présentées au moyen de la plateforme de demande en ligne de MNC. L’organisation responsable du projet doit présenter la demande avant la date limite. MNC n’évaluera que les propositions qui répondent à toutes les exigences d’admissibilité et signera des ententes avec les organisations auxquelles le financement est accordé.
Remarques : Le Musée canadien de l’histoire se réserve le droit d’annuler ou de relancer l’appel de projets à tout moment, pour quelque raison que ce soit. Si des modifications sont adoptées avant la date limite de l’appel, un avis à cet effet sera affiché sur le site Web de MNC.
Une fois la date limite de dépôt des propositions atteinte, un comité-conseil indépendant entamera le processus de sélection, qui se conclura par une liste de propositions recommandées pour du financement.
Toutes les propositions sont traitées de manière confidentielle, en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels , ainsi qu’avec toute autre loi ou règlementation applicable.
À la fin de la période d’évaluation, toutes les organisations recevront une lettre du Musée canadien de l’histoire les avisant de l’approbation ou du rejet de leur projet. Le Musée de l’histoire conclura ensuite une entente juridiquement contraignante avec chacune des organisations recevant du financement. Cette entente décrira les exigences et les responsabilités de l’organisation et du Musée de l’histoire en ce qui concerne le projet financé.
Des appels de rétroaction sont offerts pour les requérants non retenus en mai. Les organisations doivent indiquer leur intérêt dans le mois suivant la réception de leur lettre de regret. Ces commentaires seront fournis par vidéoconférence. Aucun sommaire écrit contenant des commentaires ou les notes reçues par la proposition ne seront fournis.
- Ouverture de l’appel : 15 juin
- Aide à la préparation d’une demande : de septembre à novembre
- Clôture de l’appel de projets : 1er décembre
Année suivante
- Avis d’attribution ou de refus : avant fin avril 2026
- Signature de l’entente de MNC : au plus tard le 30 juin 2026
- Date de début du calendrier du projet (c.-à-d. le lancement du projet et le début de la phase 1) : au plus tôt à la mi-juin 2026
- Signature de l’amendement de MNC et phase 1 complétée : au plus tard le 31 janvier 2027
- Date de lancement pour un projet bilingue : MNC demande que les projets soient lancés dans un délai de 2 ans maximum (c’est-à-dire le 30 juin 2028), mais ils peuvent être complétés dans un délai d’environ 18 mois
- Date de lancement pour un projet trilingue : MNC demande que les projets soient lancés dans un délai de 2.5 ans maximum (c’est-à-dire le 31 décembre 2028), mais ils peuvent être complétés dans un délai d’environ 24 mois
Remarque : chaque organisation et chaque projet sont différents. Calculez une date de lancement en tenant compte de toutes les tâches à accomplir dans le calendrier et de la complexité du projet.
Admissibilité
Les organisations ne peuvent soumettre qu’une seule proposition par appel, soit dans le cadre du programme Histoires de chez nous, soit dans le cadre des Projets numériques.
Les organisations ne peuvent pas faire partie du portefeuille de Patrimoine canadien.
Pour avoir accès au financement de Musées numériques Canada, les organisations admissibles doivent satisfaire aux critères de Objectifs principaux et mandat ainsi que Statut juridique.
Objectifs principaux et mandat
Le financement de Musées numériques Canada est réservé aux musées, aux organisations patrimoniales, culturelles ou autochtones* établis et actifs au Canada, gérant une installation physique ou un site ouvert au public, ou offrant de la programmation au public sur plusieurs sites ou par le biais d’un site Web.
*Comprend des organisations issues de Premières nations, et de communautés métisses et inuit dont l’objectif principal est la préservation du patrimoine culturel.
Statut juridique
Le financement de Musées numériques Canada est réservé aux entités suivantes :
Organismes de bienfaisance enregistrés
Selon l’Agence du revenu du Canada, un organisme de bienfaisance enregistré est une personne morale ou une fiducie qui est enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et apte à délivrer des reçus officiels pour dons.
OU
Nations, groupes ou organisations autochtones qui exercent des activités semblables à celles d’un organisme à but non lucratif et qui soutiennent les patrimoines et cultures autochtones.
OU
Organismes sans but lucratif constitués en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Selon l’Agence du revenu du Canada, un organisme à but non lucratif ne doit verser aucun revenu, ni rendre ce revenu disponible pour le bénéfice personnel des propriétaires, membres ou actionnaires de l’organisation.
OU
Organismes patrimoniaux municipaux, provinciaux ou émanant d’une Première Nation, ou encore des organismes affilié à une université.
L’organisme doit exercer ses activités de façon indépendante et neutre, et avoir un mandat, un personnel et un système de gouvernance distincts.
Au moment de présenter une proposition (le 1er décembre au plus tard), l’organisation demandeuse doit avoir existé et avoir un statut juridique depuis au moins un an.
Exemples d’organisations admissibles : les musées, les galeries, les centres culturels ou les organisations patrimoniales autochtones, les sites historiques, les sociétés historiques, les centres des sciences, les jardins botaniques, les planétariums, les centres gérés par des artistes, les archives, les zoos, les aquariums, etc.
Les organisations ne peuvent pas faire partie du portefeuille de Patrimoine canadien.
Exemples d’organisations non admissibles : les associations de musées, les associations professionnelles, les organisations de membres, les centres communautaires, les centres de loisirs, les magazines et les sociétés d’édition.
Toute organisation qui a déjà reçu un financement de Musées numériques Canada et qui souhaite présenter une proposition dans le cadre de l’appel de propositions de cette année doit avoir terminé tous les projets existants financés par Musées numériques Canada avant la date limite du 1er décembre. Autrement dit, une nouvelle proposition ne peut pas être présentée si un projet préalablement financé est encore en développement.
Avant d’investir du temps dans une proposition, il est essentiel que les nouvelles organisations demandeuses se familiarisent avec l’admissibilité au programme de Musées numériques Canada et présentent une demande d’admissibilité sur la plateforme de demande en ligne aux fins d’examen. Musées numériques Canada informera les demandeurs de leur décision quant à l’admissibilité dans un délai d’environ 10 jours ouvrables.
Musées numériques Canada encourage les organisations à remplir leur demande d’admissibilité dès que possible. Si une organisation décide de présenter une proposition avant l’examen de son admissibilité par Musées numériques Canada, elle accepte de reconnaître que l’organisation peut ne pas être admissible au financement de Musées numériques Canada et que la proposition pourrait être rejetée sur la base de l’admissibilité.
Vérification de l’admissibilité
Dans la demande d’admissibilité, les organisations devront fournir ce qui suit :
- Le mandat officiel de l’organisation.
- Une brève justification comprenant un exemple concret provenant de l’année écoulée, expliquant comment elles font participer le public à au moins quatre des fonctions muséales et patrimoniales suivantes :
- expositions;
- programmation;
- recherche;
- collections – Les collections peuvent comprendre notamment du matériel artistique, scientifique, culturel, traditionnel et historique. Elles peuvent consister en des objets physiques ou en un patrimoine culturel intangible;
- préservation;
- documentation;
- diffusion.
- Preuve du statut juridique :
- Pour les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif constitués en vertu d’une loi fédérale ou provinciale : leur numéro d’enregistrement.
- Pour les nations, les groupes ou les organisations autochtones qui exercent des activités semblables à celles d’un organisme à but non lucratif et qui soutiennent les patrimoines et cultures autochtones : une explication.
- Pour un organisme patrimonial municipal, provincial ou de bande, ou un organisme affilié à une université : une explication.
Musées numériques Canada se réserve le droit de prendre sa propre décision quant à l’admissibilité et de réviser les critères de chaque appel de propositions. Une preuve d’admissibilité peut être demandée à tout moment au cours du processus d’examen des propositions.
Projets admissibles :
Les projets doivent être créés au moyen de la plateforme de conception de MNC. Explorez la vidéo promotionnelle pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles sur la nouvelle plateforme et assurez-vous que ce que vous proposez est possible dans l’outil.
Bien que le projet puisse utiliser des contenus ou des recherches existants comme point de départ, il doit être conçu comme un tout nouveau produit en ligne, avec une expérience utilisateur distincte.
Projets non admissibles :
- les expositions/expériences sur place;
- les sites Web institutionnels et d’entreprises;
- les éléments commerciaux (p. ex. plateformes de commerce électronique);
- les bases de données/archives en ligne ou la numérisation (sans expérience utilisateur centrée sur une histoire numérique);
- les répliques de produits existants (p. ex. visite d’une exposition sur place ou numérisation d’un catalogue).
Propositions
☐ Seules les propositions reçues avant le 1er décembre à 17 h HNE seront évaluées. MNC n’acceptera pas les soumissions tardives, quelle qu’en soit la raison.
☐ L’organisation atteste que les réponses à la proposition sont véridiques et exactes à sa connaissance.
En cas d’attribution, l’organisation s’engage à respecter les exigences suivantes :
Entente
☐ Dès la confirmation du financement, une entente avec MNC doit être signée au plus tard le 30 juin 2026, et l’amendement doit être signé au plus tard le 31 janvier 2027, ou plus tôt.
Esprit de la proposition
☐ Le projet doit être comparable à la proposition en termes d’ampleur et de vision.
Esprit du programme
☐ L’organisation veillera à ce que le projet soit respectueux, ouvert, inclusif et accessible. Le projet doit respecter le sujet traité, les publics cibles et les communautés.
☐ Le projet ne peut être utilisé à des fins politiques, idéologiques ou religieuses, ni à des fins commerciales ou de collecte de fonds.
Produit en ligne distinct
☐ Le projet doit être hébergé sur la plateforme Histoires de chez nous, disponible sur les sites web du MNC et Histoires de chez nous.
☐ Le projet ne peut pas être une réplique d’une exposition ou d’un produit existant sur place ou en ligne (comme un catalogue numérisé ou une copie d’une exposition physique). Le projet peut utiliser des recherches ou des documents existants comme point de départ, mais doit être un produit unique conçu pour un public en ligne.
Langues
☐ Le projet doit être produit et traduit professionnellement (incluant une révision comparative) en français et en anglais. Le projet peut également être produit dans d’autres langues si souhaité.
Date limite du lancement
☐ Date de lancement des projets bilingues : au maximum, MNC exige que les projets soient lancés dans un délai de 2 ans, (soit le 30 juin 2028), mais les projets peuvent être réalisés dans un délai d’environ 18 mois.
OU
☐ Date de lancement des projets trilingues : au maximum, MNC exige que les projets soient lancés dans un délai de 2,5 ans (c’est-à-dire le 31 décembre 2028), mais les projets peuvent être achevés dans un délai d’environ 24 mois.
Visibilité de MNC
☐ L’organisation accepte de mentionner MNC dans tous les documents de
communication (communiqués de presse, messages sur les médias sociaux, etc.) avec le crédit :
« Réalisé grâce à Musées numériques Canada, un programme d’investissement administré par le Musée canadien de l’histoire. » [Logo de MNC]
☐ L’organisation demandera et obtiendra l’approbation préalable du matériel de communication qui mentionne le Musée.
Processus de demande
Seules les propositions présentées par l’entremise de la plateforme de demande en ligne seront acceptées.
- Examiner toutes les lignes directrices de programme de MNC et les conditions d’admissibilité.
- Si vous le souhaitez, participer aux séances d’aide à la préparation d’une demande.
- S’il s’agit d’un demandeur déjà existant : s’identifier au moyen d’un compte existant sur la plateforme de demande en ligne.
- S’il s’agit d’une nouvelle organisation demandeuse : créer un profil sur la plateforme de demande en ligne.
- Remplir le questionnaire d’admissibilité – MNC confirmera l’admissibilité de l’organisation dans un délai de 10 jours ouvrables.
- Il est recommandé que les nouvelles organisations demandeuses reçoivent la confirmation de leur admissibilité avant d’investir du temps dans la rédaction de la proposition.*
- Sélectionner un volet d’investissement – une seule proposition peut être soumise par organisation.
- (Facultatif) Remplir le questionnaire d’énoncé en matière d’équité, de diversité, d’inclusion et d’accessibilité.
- Répondre aux questions de la proposition.
- Préparer et télécharger la documentation connexe suivante :
- Calendrier d’Histoires de chez nous (en utilisant le gabarit calendrier – projet bilingue 2025 ou le gabarit calendrier – projet trilingue 2025)
- Budget – Histoires de chez nous (en utilisant le gabarit budget 2025)
- Lettre de soutien (en utilisant le gabarit lettre de soutien ou un autre format)
- Estimations (le cas échéant)
- Soumettre votre proposition avant 17 h (heure de l’Est) le 1er décembre 2025.
* Si une organisation décide de présenter une proposition avant l’examen de son admissibilité par MNC, elle accepte de reconnaître que l’organisation peut ne pas être admissible au financement de MNC et que la proposition pourra être rejetée sur la base de l’admissibilité.
Remarque : Les propositions présentées après la date limite de l’appel de projets ne seront pas examinées. Le Musée canadien de l’histoire, qui administre le programme d’investissement de MNC, se décharge de toute responsabilité à cet égard et n’acceptera aucun transfert de responsabilité. L’organisation qui propose un projet assume seule la responsabilité de tout risque et de toute conséquence découlant d’une présentation incorrecte.
L’aide à la préparation d’une demande et les ressources suivantes peuvent contribuer à renforcer une proposition.
Séances d’information
Assister à une présentation virtuelle d’une heure pour :
- en savoir plus sur le volet d’investissement « Histoires de chez nous »;
- comprendre l’admissibilité de l’organisation et du projet;
- en savoir plus sur le processus de proposition;
- mieux comprendre les critères clés qui peuvent faire la différence dans le succès d’une proposition.
Heures de bureau (bilingue)
- le 2 octobre 2025 à 11 h (HAE) (bilingue)
- le 9 octobre 2025 à 12 h (HAE) (bilingue)
- le 15 octobre 2025 à 13 h (HAE) (français)
- le 16 octobre 2025 à 13 h (HAE) (anglais)
- le 23 octobre 2025 à 14 h (HNE) (bilingue)
- le 30 octobre 2025 à 15 h (HNE) (bilingue)
Participer à une séance de groupe d’une heure pour poser à un-e agent-e de programme de MNC une question précise sur la proposition de votre organisation.
Remarque : L’agent-e de programme ne peut pas répondre à des questions subjectives sur la possibilité que votre sujet, votre thème ou votre projet reçoive un financement. Un comité consultatif indépendant sélectionne les projets recommandés pour investissement, ce qui limite les questions qui peuvent être posées.
Séances de de mentorat
Les demandeurs admissibles sélectionnés participent à une réunion individuelle de 30 minutes avec un-e agente-e de programme de MNC qui leur fournit une aide personnalisée, répond à leurs questions et renforce la proposition de l’organisation.
Cette initiative s’adresse aux organisations qui déposent une première demande à MNC et aux groupes méritant d’être traités selon les critères d’équité décrits dans la Déclaration d’équité de Musées numériques Canada.
Soumettre une expression d’intérêt au plus tard le 7 octobre 2025. Le nombre de places est limité. Un tirage au sort sera effectué si le nombre de demandeurs est supérieur au nombre de places disponibles. Les organisations seront informées au plus tard le 14 octobre 2025.
Questions relatives à la demande
Continuer de s’informer :
- S’inscrire à l’infolettre de MNC
Ressources :
Questions et astuces
Seules les propositions soumises par l’entremise de la plateforme de demande en ligne seront acceptées.
Documents importants
• Histoires de chez nous : Gabarit budget 2025
• Histoires de chez nous : Gabarit calendrier (projets bilingues) 2025
• Histoires de chez nous : Gabarit calendrier (projets trilingues) 2025
• Gabarit lettres d'appui
• Histoires de chez nous : Exemple d’entente 2025
1. Titre (aucun point attibué)
Quel est le titre de l’Histoire de chez nous ? Il peut s’agir d’un titre provisoire. (20 mots maximum)
2. Subjet (10 points)
Quel est le sujet de l’Histoire de chez nous ? (150 mots maximum)
Conseils :
- Décrire le sujet ou le thème de l’Histoire de chez nous. Un sujet plus défini est préférable à un sujet plus étendu.
- Le programme de MNC est centré sur les histoires numériques « digital storytelling ». Quels sont les messages clés? Quelle est l’idée phare que le public cible doit retenir de cette expérience?
- Si le sujet est vaste ou couvre une longue période, indiquer les thèmes, les personnes, les événements ou les lieux sur lesquels le projet se concentrera.
3. Public cible (15 points)
3a. Quel est le public cible de l’Histoire de chez nous? Comment en bénéficiera-t-il ? (250 mots maximum)
Conseils :
- Un public cible est un groupe de personnes définies par certaines motivations ou caractéristiques, ou certains comportements. Il faut faire preuve d’autant de précision que possible sur les personnes à atteindre et sur la raison pour laquelle l’Histoire de chez nous s’adresse à elles. « La population canadienne », à titre d’exemple, désigne un public cible trop large et le contenu sera trop générique.
- Le public cible peut être multiple et défini en fonction de plusieurs facteurs, notamment la situation géographique, la tranche d’âge, les intérêts, les motivations et les antécédents culturels.
3b. Pourquoi le public cible s’intéresse-t-il au sujet ou s’y investit-il ? (300 mots maximum)
Conseils:
- Définir les résultats ou les avantages propres au public cible. Il s’agit par exemple d’informer, d’enseigner, d’établir un lien, d’inspirer, de surprendre, d’enchanter, de provoquer une action ou d’inspirer un changement d’attitude.
- En ce qui concerne les liens avec le programme scolaire, il est recommandé d’établir un lien avec des niveaux scolaires ou des matières spécifiques (par exemple, les élèves de 4eannée de la Colombie-Britannique, le programme de sciences, la géologie en particulier). Il est à noter que les compétences du programme d’études sont très différentes selon la province, l’âge et le niveau scolaire. Il faut éviter les généralisations telles que « de la maternelle à la 12e année » ou « l’ensemble des élèves du secondaire ».
4. Pertinence (25 points)
Pourquoi le sujet de l’Histoire de chez nous est-il important ? (500 mots maximum)
Conseils :
- Expliquer en quoi le projet est pertinent et opportun pour l’organisation, le public cible et la communauté au sens large. Les questions à se poser sont les suivantes
- Pourquoi maintenant ?
- Pourquoi le sujet est-il essentiel ?
- Comble-t-il une lacune dans les connaissances sur le sujet ou l’histoire ?
- Encourage-t-il la participation de la communauté?
- Raconte-t-il une histoire inédite sur une communauté ?
- Offre-t-il une nouvelle perspective ?
- Soutient-il le patrimoine autochtone ou la préservation des langues ?
- Soutient-il la vérité et la réconciliation, ainsi que le rapatriement ?
- Soutient-il l’histoire des personnes autochtones, racialisées ou de la communauté 2ELGBTQI+ ?
- Soutient-il les diasporas ou les communautés linguistiques minoritaires ?
- Soutient-il les communautés confrontées à des problèmes d’accessibilité ?
5. Trame narrative
Quelle histoire est-ce que l’Histoire de chez nous raconte ? (500 mots minimum, 1000 mots maximum)
Conseils :
- Comment l’histoire est-elle structurée, et pourquoi? Différentes formes d’organisation peuvent être envisagées :
- de manière chronologique;
- centrée sur des personnes, des lieux, des objets, des œuvres d’art, etc.;
- de manière thématique.
- Quels éléments de l’outil de création des Histoires de chez nous seront utilisés :
- cartes;
- chapitres;
- citations;
- extaits sonores;
- images;
- images interactives (hot spots);
- intégration(s) 3D;
- ligne de temps.
6. Contenu
Décrire les ressources médiatiques ou les collections qui seront utilisées dans le projet, et expliquer comment ces éléments soutiennent la trame narrative. (500 mots minimum, 1000 mots maximum)
Conseils :
- Les ressources médiatiques peuvent comprendre des images d’artéfacts, de spécimens, d’objets ou d’œuvres d’art, des documents d’archives, des entretiens avec des membres de la communauté, des enregistrements sonores et vidéos, des enregistrements d’histoire orale et d’autres médias.
- Indiquer clairement si le matériel existe déjà ou s’il sera numérisé ou créé pour le projet.
- Indiquer les quantités pour chaque type de contenu (p. ex., six entretiens vidéos) ou des estimations si les quantités exactes ne sont pas connues. Plus le contenu est détaillé en ce qui concerne les types et la quantité de contenu, mieux c’est.
- Indiquer les sources de cette documentation. Les sources peuvent inclure la collection ou les archives de l’organisation, ou des documents provenant d’autres musées, de bibliothèques, d’organisations communautaires et de membres de la communauté.
Conseils généraux pour les questions 7, 8 et 9 :
L’équipe de projet, le calendrier et le budget doivent être arrimés à l’ampleur du projet.
- Par exemple, un projet présentant des vidéos d’histoire orale dans une langue indigène n’a pas les mêmes besoins qu’un projet de recherche intensive ou qu’un projet nécessitant une nouvelle numérisation importante d’artefacts.
- Équipe de projet (question no 7) : devrait inclure tous les rôles et responsabilités nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que l’expertise de la personne désignée.
- Calendrier (question no 8) : devrait comprendre une liste de toutes les tâches ou étapes, leur durée et les personnes affectées à chacune d’elles.
- Budget (question no 9) : devrait inclure des lignes pour toutes les dépenses liées à la production du projet (salaires, contrats, honoraires, etc.).
- Dans l’exemple du projet d’histoire orale décrit ci-dessus :
- L’équipe de projet devrait inclure les personnes responsables de la coordination des consultations dans la communauté, de la vidéographie, de la technique d’enregistrement/son et de la traduction.
- Le calendrier devrait prévoir du temps pour les réunions de consultation communautaire avec les Aînés, les entrevues, les enregistrements vidéo et la traduction.
- Le budget devrait inclure les frais de déplacement, les coûts salariaux liés à la coordination communautaire, aux honoraires des membres de la communauté, aux coûts pour la vidéographie, de la technique d’enregistrement/son, de la production vidéo et de la traduction.
Ces besoins spécifiques s’ajoutent aux autres rôles essentiels, au calendrier et aux lignes budgétaires que MNC attend pour chaque projet (comme la coordination du projet, le développement créatif et la création de contenu, la rédaction, le développement Web, etc.).
- Consultez « Créer des expériences en ligne stimulantes : introduction à l’intention des musées et des organismes patrimoniaux » pour obtenir d’autres conseils utiles.
7. Équipe de projet
Dresser une liste de rôles nécessaires pour réaliser le projet, les tâches dont les personnes sont responsables et la personne désignée pour chaque rôle.
Conseils :
- MNC recommande d’inclure ces rôles clés (au minimum) :
- Gestion/coordination de projet*
- Conservation/recherche
- Rédaction
- Traduction professionnelle
- Révision professionnelle
- D’autres rôles sont à envisager (le cas échéant) :
- Éducation/Planification de l’interprétation
- Archivistique/ numérisation
- Photographie
- Réalisation de vidéos
- Technique du son
- Réalisation d’entrevues
- Consultation communautaire
- Spécialistes en marketing/communication (ils doivent être payés en nature et ne constituent pas des dépenses admissibles pour MNC)
- Dans la mesure du possible, inclure dans l’équipe principale de projet des membres de la communauté dont l’histoire est représentée.
- Prévoir une consultation réelle de la communauté avant, pendant et après le lancement du projet. Expliquer votre engagement dans ce travail et fournir une lettre d’appui démontrant ces relations continues.
- L’équipe de projet peut comprendre du personnel salarié de l’organisation demandeuse ainsi que des personnes de l’externe engagées grâce au financement de MNC pour combler des rôles.
- Habituellement, les personnes responsables de la révision et de la traduction sont recrutées à l’externe avec les fonds de MNC.
- Si certains rôles ne sont pas encore remplis, expliquer la stratégie pour les combler.
- Une personne peut jouer plus d’un rôle, mais il faut tenir compte de ses capacités.
- Dans la mesure du possible, tous les rôles doivent être rémunérés. Veiller à ne pas trop compter sur les bénévoles, les étudiants ou le personnel temporaire.
* Gestionnaire de projet
- Assure la liaison avec MNC et guide le projet du début jusqu’au lancement. Coordonne la réalisation des tâches et veille au respect du calendrier et du budget.
8. Calendrier
Créez un calendrier de projet en utilisant le modèle de calendrier avec l’une ou l’autre des options suivantes :
- Histoires de chez nous : Gabarit calendrier (projets bilingues) 2025
- Histoires de chez nous : Gabarit calendrier (projets trilingues) 2025
Enregistrez le fichier sous le nom de : 2025_Histoires de chez nous_NOM DE L’ORGANISATION_Calendrier
Dates importantes :
- Avis d’attribution ou de refus : avant fin avril 2026
- Signature de l’entente de MNC : au plus tard le 30 juin 2026
- Date de début du calendrier (c.-à-d. le lancement du projet et le début de la phase 1) : au plus tôt à la mi-juin 2026
- Signature de l’amendement de MNC et clôture de la phase 1 : au plus tard le 31 janvier 2027
- Date de lancement pour un projet bilingue : MNC demande que les projets soient lancés dans un délai de 2 ans maximum (c’est-à-dire le 30 juin 2028), mais ils peuvent être complétés dans un délai d’environ 18 mois.
- Date de lancement pour un projet trilingue : MNC demande que les projets soient lancés dans un délai de 2.5 ans maximum (c’est-à-dire le 31 décembre 2028), mais ils peuvent être complétés dans un délai d’environ 24 mois.
Remarque : chaque organisation et chaque projet sont différents. Calculez une date de lancement en tenant compte de toutes les tâches à accomplir dans le calendrier et de la complexité du projet.
Conseils :
Dans le calendrier, il faut détailler toutes les étapes, du démarrage du projet jusqu’à son lancement.
- Pour chaque étape ou tâche :
- Indiquer le membre de l’équipe du projet responsable et la durée.
- Indiquer les tâches qui sont dépendantes les unes des autres ou qui peuvent être exécutées simultanément.
Veiller à ce que le calendrier reflète le processus de MNC :
- Inclure les 3 (ou 4) phases de MNC (Phase 1 : Plan de production, Phase 2 : Version préliminaire – unilingue, Phase 3 : Version finale – français et anglais, Phase 4 : Version troisième langue (optionnelle; uniquement pour les projets qui offre une troisième langue)
- Inclure les produits livrables de MNC associés à chaque phase.
- Prévoir le délai pour la révision par MNC des produits livrables (10 jours ouvrables pour la phase 1 et 20 jours ouvrables pour les autres phases). Prévoir deux cycles de révision pour les phases 2 à 4 ainsi que le temps nécessaire pour effectuer les corrections et ajustements recommandés par MNC.
En plus des produits livrables et des phases de MNC identifier dans le calendrier toutes les tâches requises pour développer le projet. Par exemple :
- Développement du contenu
- Recherche
- Curation
- Éducation/Planification en interprétation
- Sélection de contenus, de médias, ou de collections existantes
- Création de nouveaux contenus : numérisation, photographie, vidéo, enregistrements, entrevues, etc.
- Demandes de prêt ou d’images provenant d’autres collections
- Autorisations d’images ou de droits d’auteur
- Textes (textes principaux, textes de remplacement, sous-titrages codés et transcriptions)
- Rédaction (dans la langue d’origine)
- Révision professionnelle (dans la langue d’origine)
- Traduction professionnelle (vers d’autres langues)
- Révision professionnelle de la traduction
- Révision comparative (pour vérifier l’équivalence de la traduction dans les autres langues)
- Consultation de la communauté (prévoir du temps avant, pendant et après le lancement pour s’assurer que la communauté participe au développement du projet)
- Lancement du projet
- Promotion/communication
9. Budget
Établir un budget décrivant le coût global du projet, y compris :
- demande d’investissement à MNC
et fortement recommandé,
- contributions de l’organisation principale (en nature ou financières)
et si pertinent
- autres sources (c.-à-d. d’autres partenaires ou soutiens financiers).
Le budget doit être rempli à l’aide du gabarit budget Histoires de chez nous 2025.
Instructions pour le gabarit de budget :
- Enregistrer le fichier sous le nom de : 2025_Histoires de chez nous_NOM DE L’ORGANISATION_Budget
- MNC investit 25 000 $ CAN dans chaque Histoire de chez nous produite en anglais et en français.Si l’Histoire de chez nous est destinée à être produite dans une troisième langue :
- Comme les coûts de traduction peuvent varier en fonction de la langue, le montant de l’investissement fourni par MNC est de 25 000 $, plus les coûts réels de la traduction vers la troisième langue et une allocation de 2 000 $ versée à l’organisation.
- MNC se réserve le droit de fixer un investissement maximal pour les coûts de traduction de la version dans une troisième langue, en fonction des fonds disponibles. Les organisations pourraient être appelées à ajuster leur nombre de mots. À titre indicatif, les Histoires de chez nous comptent généralement entre 10 000 et 20 000 mots afin d’offrir une expérience de narration numérique engageante et accessible.
- Utiliser la colonne « MNC » pour le montant demandé à MNC pour les dépenses admissibles de MNC.
- Utiliser la colonne « organisation principale» pour les contributions (financières ou en nature) de l’organisation principale.
- (Facultatif) Utiliser la colonne « autres sources » pour tout autre partenaire ou soutien financier confirmés qui apportera une contribution.
- D’abord, sélectionner la « catégorie » dans la liste déroulante. Ensuite, choisir la Indiquer « autre » si l’élément n’est pas répertorié.
- Si l’élément sélectionné n’est pas admissible à l’investissement de MNC, les cellules seront grisées. Indiquer plutôt le coût dans la rubrique « organisation principale » ou « autres sources ».
- Dans la colonne « description », fournir une explication, une base de calcul ou des , le fournisseur et autres détails.
- Dans la mesure du possible, utiliser des chiffres réels et télécharger des devis dans la rubrique « Lettres d’appui » de la demande. Éviter les estimations « au pif » et les montants élevés sans justification; donner plutôt des détails sur les tâches ou les dépenses liées à chaque montant.
Les dépenses admissibles pour un investissement de MNC doivent être directement liées à la production du projet en ligne.
Gestion de projet
- Gestionnaire de projet
- Soutien administratif
Création de contenu et médias * (médias existants, nouvellement numérisés ou nouvellement créés, tels que des images, des vidéos, des images 3D, des artefacts, des œuvres, des enregistrements, etc.)
- Conservateur
- Recherche
- Planification de l’interprétation
- Spécialiste en éducation
- Archiviste/Spécialiste de la numérisation
- Droits d’auteur et propriété intellectuelle : autorisation de droits ou redevances pour la durée du projet (cinq ans)
- Photographe
- Vidéaste
- Monteur vidéo
- Technicien du son
- Artiste
- Animateur
- Musicien
* Les œuvres et les médias nouvellement créés doivent être utilisés spécifiquement pour et figurer dans le projet numérique. Les créateurs devraient recevoir les droits appropriés pour la création et les droits d’auteur de leurs œuvres.
Autres spécialistes
- Personne ressource en programmes d’études
- Personne ressource communautaire
- Membres de la communauté (avec rétribution)
- Spécialiste en évaluation
- Participant-es aux tests utilisateurs (avec rétribution)
- Personne ressource en accessibilité
Frais de déplacement
- Les frais de déplacement doivent être directement liés à la recherche, à la création de contenu ou à la consultation de la communauté et justifiés dans le budget et la description du projet.
- Certains coûts ne sont pas admissibles à l’investissement.
- Les coûts non admissibles de MNC doivent néanmoins être détaillés dans le budget, afin que le coût total du projet soit pris en compte, et ces coûts doivent être répartis dans les colonnes « organisation principale » ou « autres sources ».
Coûts non admissibles
- Taxes sur toutes les dépenses, quelle que soit la situation fiscale de l’organisation.
- Frais administratifs tels que la location d’un espace de bureau, l’équipement de bureau ou l’impression.
- Réserves pour imprévus.
- Frais indirects.
- Tous les achats d’immobilisations tels que : ordinateurs, disques durs, cartes mémoire, serveurs, logiciels (et licences), téléphones portables (et plans de données), tablettes, appareils-photo, caméras vidéo, drones, matériel d’enregistrement sonore, etc.
- La location d’équipement est admissible, mais MNC encourage les organisations à embaucher des professionnels techniques dans la mesure du possible. Par exemple, envisager de faire appel à une société de production vidéo expérimentée plutôt que de louer une caméra vidéo.
- Coûts post lancement : tels que les évaluations analyses rétrospectives, les évaluations des utilisateurs après le lancement, et les mises à jour du contenu après le lancement.
Projets non admissibles :
- les expositions/expériences sur place;
- les sites Web institutionnels et d’entreprises;
- les éléments commerciaux (p. ex. plateformes de commerce électronique);
- les bases de données/archives en ligne ou la numérisation (sans expérience utilisateur centrée sur une histoire numérique );
- les répliques de produits existants (p. ex. visite d’une exposition sur place ou numérisation d’un catalogue);
Nombre de mots, tarifs de traduction et de révision
- Nombre de mots
- Pour les Histoires de chez nous, il est recommandé que le corps du texte du projet contienne environ 10 000 à 25 000 mots. Toutefois, cela peut varier en fonction de la nature du projet.
- N’oubliez pas que les textes de remplacement, les sous-titres et les transcriptions sont obligatoires et augmentent le nombre de mots.
- Lignes directrices sur les tarifs * (en anglais ou en français) :
- Traduction : 0,25 à 0,40 $/mot ou 40 à 70 $/heure
- Révision : 0,10 à 0,20 $/mot ou 20 à 65 $/heure
* Les tarifs indiqués sont approximatifs et ne visent qu’à donner une idée générale du prix. Les tarifs peuvent varier d’une région à l’autre du Canada, ainsi que pour d’autres langues, notamment les langues autochtones. Des traducteurs et des réviseurs professionnels sont requis (le travail ne peut pas être réalisé au moyen de services d’intelligence artificielle).
- Les contributions en nature, les partenariats et autres financements peuvent renforcer un projet, mais ne sont pas obligatoires.
- Voici quelques exemples de contributions en nature :
- temps/salaires du personnel;
- accès aux collections, utilisation d’équipements ou numérisation (à titre gracieux ou à tarif réduit);
- financement reçu d’une autre source, d’une autre subvention ou d’un autre programme.
10. Lettres d’appui
Conseils :
- Demandez aux partenaires ou aux membres de la communauté de fournir une brève lettre d’appui et téléchargez-la avec la proposition. Ils peuvent rédiger leur propre texte ou utiliser le gabarit de la lettre d’appui de MNC.
- Les lettres ne sont pas obligatoires, mais sont fortement recommandées, car elles démontrent la passion et l’engagement des autres dans la réalisation du projet.
- Penser à télécharger des devis de traducteurs ou d’autres spécialistes afin de valider les chiffres du budget.
11. Texte promotionnel
Fournir un texte promotionnel décrivant le projet. (150 mots maximum)
MNC publiera ce texte dans le communiqué de presse en cas d’attribution du projet.
Produits livrables
Les projets Histoires de chez nous produites en français et en anglais sont construites en 3 phases et doivent être lancées dans un délai de 24 mois ou moins.
Les projets Histoires de chez nous qui incluent une version en troisième langue sont construites en 4 phases et doivent être lancées dans un délai de 30 mois ou moins.
Remarques : Chaque produit livrable sera assujetti à au moins un cycle d’examen d’assurance de qualité de MNC, qui peut prendre jusqu’à 10 jours pendant l’étape 1 et jusqu’à 20 jours pendant les autres étapes.
Chaque organisation recevant du financement doit signer une entente juridiquement contraignante avec le Musée canadien de l’histoire. Toutes les parties acceptent de se conformer intégralement à la documentation de la demande de propositions, ainsi qu’à l’entente et à ses annexes, notamment :
À la signature de la présente entente, au plus tard le 30 juin 2026, l’organisation recevra une avance de 5 % du montant maximal de l’investissement pour les travaux à réaliser au cours de la phase 1.
L’organisation clarifie la proposition soumise afin d’affiner le projet. Les membres de l’équipe de projet et les sous-traitants sont confirmés. Une consultation communautaire sera effectuée, s’il y a lieu, lorsqu’elle est nécessaire au commencement du projet.
- Produit livrables :
- Budget révisé
- Équipe de projet confirmée
- Calendrier révisé – qui devient l’annexe A : Produits livrables et modalités pour la remise de fonds
- Description révisée du projet – qui devient l’annexe B : Description et portée du projet
- Amendement de l’entente :
- D’ici la fin de la phase 1, l’organisation préparera les annexes de l’entente, fera les ajustements requis et signera dûment l’amendement.
- Remise de fonds :
- À la signature de l’amendement, l’organisation recevra le solde du premier versement du financement (35 % du financement total).
- Cette phase peut durer au maximum sept mois (31 janvier 2027), mais doit idéalement être plus courte.
- Produits livrables :
- Version préliminaire du projet (en français ou en anglais) livrée au moyen de la plateforme de conception du site Web Histoires de chez nous
- Exemple de traduction d’au moins 250 mots
- Remise de fonds : 40 %
- Produits livrables :
- Version finale du projet – français et anglais incorporant toutes les révisions
- Formulaire de lancement et images promotionnelles
- Lancement d’Histoire de chez nous
- Remise de fonds : 20 %
- Produits livrables :
- Version finale dans la troisième langue
- Formulaire de lancement de MNC et images promotionnelles
- Lancement d’Histoire de chez nous
- Remise de fonds : Au moment du lancement, paiement de l’allocation de 2 000 $ CAD et des coûts actuels de la traduction dans la troisième langue (facture requise).
Après la soumission, Musées numériques Canada disposera de 10 jours ouvrables réviser la phase 1 et de 20 jours ouvrables pour les autres phases. L’approbation peut nécessiter plusieurs cycles de révision, à la discrétion de MNC. Il faut prévoir au moins deux cycles pour chaque phase.
Pour plus d’informations, consultez l’exemple d’entente du MNC – Histoires de chez nous 2025.
Toutes les Histoires de chez nous doivent être disponibles en français et en anglais.
Les organisations peuvent développer des projets dans la langue de leur choix, mais doivent faire traduire la version originale dans l’autre langue officielle et la faire réviser pour s’assurer que le projet est d’égale qualité dans les deux langues.
Les organisations peuvent également produire des projets dans d’autres langues, par exemple dans une langue autochtone.
La plateforme de conception du site Web est essentiellement un outil de gestion de contenu. Le contenu est entré dans l’outil, qui crée ensuite des pages Web. Les textes et les éléments de contenu doivent répondre à certaines exigences techniques et d’accessibilité. MNC effectuera une vérification pour voir si ces exigences sont respectées et fournira des commentaires et des conseils à l’organisation.
Les exigences techniques et d’accessibilité sont les suivantes :
- Images
- Formats des fichiers d’images : JPEG/JPG, PNG et GIF
- Taille des fichiers JPG : 2 000 pixels (largeur et hauteur), 72 ppp et 2 mégaoctets (MB) maximum
- Le format préféré est le JPG, mais des fichiers PNG et GIF peuvent être utilisés dans certaines circonstances particulières (à discuter avec MNC).
- Clips audios (facultatif)
- Fichiers MP3, 320 kb/s (stéréo acceptée), 44 Hz, mono (approx. 1 MB par minute)
- Clips vidéos (facultatifs)
- L’organisation devra créer un compte YouTube si ce n’est pas déjà fait.
- Les fichiers vidéos doivent être téléchargés sur YouTube, où ils seront imbriqués dans la plateforme de conception du site Web (les vidéos présentés dans le projet en ligne seront également disponibles au grand public sur YouTube).
- Accessibilité Web
- Le texte alternatif est un texte descriptif montré à l’écran quand le contenu ne peut pas être montré ou vu. Il pourrait inclure :
- un texte décrivant une image;
- une transcription descriptive reproduisant tout le dialogue dans un fichier audio et décrivant les sons autant que les paroles;
- une transcription descriptive reproduisant tout le dialogue dans un fichier vidéo et décrivant les sons autant que les paroles, de même que les scènes sans dialogue.
- Le texte alternatif est un texte descriptif montré à l’écran quand le contenu ne peut pas être montré ou vu. Il pourrait inclure :
- Les sous-titres accompagnent le clip vidéo à mesure qu’il joue (l’organisation réalisera le sous-titrage et l’imbriquera dans YouTube; les sous-titres générés automatiquement pourraient être incorrects et ne seront pas acceptés).
L’organisation assume la responsabilité d’obtenir tous les droits d’auteur légitimes des médias ou du matériel inclus dans le projet. Le cas échéant, l’organisation assume la responsabilité de tous frais associés à l’obtention des droits. Le Musée canadien de l’histoire n’est responsable d’aucune violation des droits.
Évaluation
Les propositions sont évaluées par des comités consultatifs indépendants, composés de spécialistes des musées et du numérique de tout le pays. Chaque volet d'investissement est évalué par un comité particulier.
Pour la plupart des appels de projets, le nombre de demandes reçues excède de beaucoup le budget disponible. Ainsi, toutes les propositions reçues sont évaluées dans le cadre d’un processus d’évaluation compétitif et rigoureux.
Un comité consultatif indépendant accorde des points aux réponses fournies par l’organisation en fonction de critères d’évaluation déterminés. Les propositions qui obtiennent le plus grand nombre de points (en fonction de la note moyenne) sont retenues pour discussion et évaluation consensuelle par le comité-conseil. De façon générale, les propositions doivent obtenir au minimum 70 points pour être étudiées lors de la rencontre du comité-conseil.
Le comité présente ses recommandations au Musée canadien de l’histoire. L’équipe de MNC valide l’admissibilité de chaque projet, le calendrier et le budget. MNC peut contacter les organisations pour clarifier des détails. Comme le Musée canadien de l’histoire rend des comptes au public, il se réserve le droit de rejeter les recommandations du comité-conseil.
Le financement total disponible pour tous les projets reçus dans le cadre de la demande de propositions de 2025 est actuellement de 2 200 000 dollars canadiens. MNC se réserve le droit de rajuster ce montant et d’allouer les fonds entre les volets, en fonction du nombre ou de la qualité des propositions reçues.

Danielle Dezort
Danielle Dezort est Responsable, Apprentissage et Engagement auprès des visiteurs au Musée canadien de l’histoire (MCH) et au Musée canadien de la guerre. Elle a entamé sa carrière muséale en 1999 dans des lieux historiques provinciaux, locaux et nationaux, où elle a fait de l’interprétation en personne et a occupé des postes pédagogiques. Au cours des 20 dernières années au MCH, elle s’est efforcée d’élaborer des expériences d’apprentissage créatives pour de multiples publics en partenariat avec des spécialistes et des intervenantes et des intervenants en histoire de divers milieux culturels, universitaires et éducationnels. Elle a supervisé la création de la Zone pédagogique du MCH, une ressource numérique sur l’histoire du Canada qui propose des sources primaires et des activités de grande qualité pour les élèves du pays entier. Danielle cherche à éveiller un intérêt pour l’histoire et à promouvoir l’inclusion en intégrant de multiples voix dans le récit historique et en rendant l’apprentissage de l’histoire engageant et agréable.

Terri Harlow
Terri Harlow est responsable des plateformes numériques au Musée canadien de l’immigration du Quai 21, où elle dirige la stratégie numérique, la conception de sites Web et d’applications, ainsi que des initiatives en matière d’accessibilité numérique. Ayant amorcé son parcours professionnel dans le secteur de la conception graphique pour ensuite se tourner vers le développement Web frontal, elle laisse libre cours à sa créativité en privilégiant l’expérience utilisateur par l’adoption des principes heuristiques de l’interface utilisateur et de l’expérience utilisateur, ainsi que des pratiques exemplaires connexes. Depuis son arrivée au Musée en 2009, Terri voue une véritable passion pour le mentorat et a contribué à l’épanouissement de nombreux collègues de travail, ce qui a d’ailleurs permis à beaucoup de personnes de trouver leur voie au sein des musées numériques.

Julia Lafrenière
Récipiendaire de la Médaille du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II en 2023, Julia Lafrenière (elle) est une fervente partisane du respect des réalités culturelles et du service communautaire. D’origine métisse et anichinabée, elle est membre de la Première Nation Minegozhiibe Anishnaabe vivant sur le territoire du Traité 4. Responsable de l’apprentissage, des voies autochtones et de l’équité au Musée des beaux-arts de Winnipeg depuis 2019, Julia dirige des initiatives favorisant la compréhension institutionnelle et visant à combler les écarts culturels. Ses présentations percutantes, faites notamment au Metropolitan Museum of Art de New York, témoignent de son dévouement à la cause de l’intégration du savoir autochtone. Les qualités de chef de file de Julia ne se limitent toutefois pas à ses fonctions au sein du Musée des beaux-arts. En effet, en plus d’agir à titre de conseillère dans le cadre de projets de transformation, elle assure la direction d’initiatives primées par l’Association des musées canadiens. Également consultante sur l’inclusion autochtone favorisant l’adoption de solutions équitables, elle participe à l’élaboration de politiques axées sur la sécurité et le bien-être du personnel et des clients. Julia est titulaire d’une maîtrise en études culturelles de l’Université de Winnipeg. Son engagement en matière de service communautaire et de défense des droits laisse un héritage durable et encourage d’autres personnes à emprunter la voie de la réconciliation et de l’équité.

Gerry Lawson
Ma̓la̓gius, Gerry Lawson est membre de la Nation heiltsuk et dirige actuellement le Laboratoire d’histoire orale et de langue du Musée d’anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique (UCB). Comptant plus de 15 ans d’expérience en gestion de l’information et en numérisation du patrimoine, il travaille à la création de ressources pratiques extensibles pour la préservation du patrimoine culturel autochtone et à la décolonisation des pratiques informationnelles. Gerry est également responsable du volet technologique de l’Indigitization Program (programme de numérisation des connaissances autochtones) de l’UCB, et membre du conseil d’administration du First Peoples’ Cultural Council (Conseil culturel des Premiers Peuples) et du Cercle du patrimoine autochtone.

Katie McDade
Katie McDade est spécialiste de l’apprentissage au Musée canadien de l’histoire, où elle travaille depuis huit ans. Elle détient un doctorat spécialisé dans la traite des esclaves dans l’Atlantique et a à cœur un enseignement de l’histoire inclusif et axé sur la communauté. Katie a collaboré avec des communautés de partout au Canada à diverses initiatives, dont le programme Boîte à histoire et les trousses de la Zone pédagogique, avec un intérêt particulier pour l’histoire des Noirs au Canada. Se dévouant avec passion à rendre l’histoire pertinente et intéressante, elle adore travailler avec les élèves, les enseignants et les communautés pour comprendre ce en quoi le passé continue de façonner notre monde actuel.

Nicole Nugent
Nicolle Nugent (elle) valorise la communauté, l’accessibilité et l’éducation artistique comme fondement de sa pratique curatoriale. Depuis 2002, elle travaille à la MacKenzie Art Gallery, occupant de nombreux rôles axés sur l’éducation, la programmation publique et les partenariats. Nicolle a organisé l’exposition Provisional Structures: Carmen Papalia with Vo Vo et jes sachse (2021). Elle a participé à de nombreuses occasions de perfectionnement professionnel, dont Making Museums Matter, Cultural Resource Management Program enseigné par Stephen E. Weil (Université de Victoria), ainsi que plusieurs ateliers et conférences de la National Art Education Association (NAEA), d’engage (Royaume-Uni), de l’American Alliance of Museums, l’Art Museum Educators Consortium et l’Association des musées canadiens. Elle a donné une présentation à l’École internationale d’été d’engage (2006) au Portugal, en plus d’être activement membre depuis 2009 de la direction de la Canadian Art Gallery Educators, où elle a occupé les postes de présidente en chef et de présidente sortante, ainsi que des postes liés aux études de cas.
- Titre, sujet, public cible et pertinence (total 50 points, 3 notations)
- Sujet : 10 points
- Public cible : 15 points
- Pertinence : 25 points
- Trame narrative et contenu (25 points, 1 notation)
- Équipe de projet, calendrier et budget (25 points, 1 notation)
Pour des trucs et astuces sur la façon de répondre à chacun de ces critères, des exemples de questions sur les propositions sont disponibles.
Si MNC reçoit plus de propositions que ce qu’il est possible de financer, les propositions qui obtiennent le plus grand nombre de points (en fonction de la note moyenne) sont retenues pour discussion et évaluation consensuelle par le comité-conseil. De façon générale, les propositions doivent obtenir au minimum 70 points pour être étudiées lors de la rencontre du comité consultatif.
MNC se réserve le droit de modifier le nombre de propositions discutées et financées, en fonction de considérations budgétaires. Si un nombre moindre de propositions est reçu, le comité-conseil pourrait considérer les propositions ayant reçu moins de 70 points.
MNC a l’intention de procéder par notations consensuelles pour les 15 propositions ayant les plus hauts pointages; cependant, MNC pourrait ajuster le nombre de propositions comme il lui sied et comme il lui semble raisonnable pour le programme d’investissements.
Pas certain que votre projet soit admissible ?
Consultez notre FAQ pour des réponses.
Consulter notre FAQHistoires de chez nous
Inspirez-vous en consultant notre collection d'Histoires de chez nous.
En savoir plus